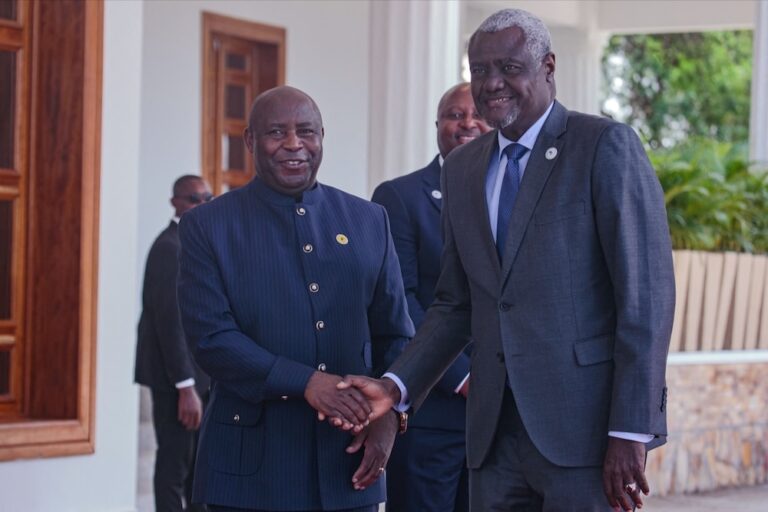"RSF exhorte les autorités burundaises à garantir sans délai la sécurité des professionnels des médias sur l’ensemble du territoire, avant, pendant et après le scrutin. Il est aussi impératif que les responsables de ces violences soient identifiés et traduits en justice."
Cet article a été initialement publié sur rsf.org le 8 mai 2025.
Arrestations arbitraires, passages à tabac, intimidations répétées… À un mois des élections législatives et locales prévues le 5 juin, la recrudescence des violences visant les journalistes au Burundi est alarmante. Alors que le pays a chuté de 17 places dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2025 établi par Reporters sans frontières (RSF) – se plaçant désormais au 125e rang sur 180 –, l’organisation appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour que les professionnels des médias puissent exercer en toute sécurité et sans crainte de représailles.
Depuis le début du mois d’avril, RSF a recensé au moins quatre cas graves d’atteintes à la liberté de la presse au Burundi, impliquant manifestement les forces de l’ordre ou des membres présumés de la branche jeunesse du parti au pouvoir (CNDD-FDD), qui se font appeler les “Imbonerakure”.
La dernière agression en date, d’une brutalité inouïe, remonte au 28 avril. Le journaliste de la radio indépendante Bonesha FM, Willy Kwizera, a été arrêté, séquestré et violemment battu par des membres présumés des “Imbonerakure”. Il réalisait un reportage sur les conditions de vie des étudiants à l’université du Burundi, à Bujumbura, lorsque ses agresseurs l’ont enfermé dans un bureau, dépouillé de ses effets personnels et roué de coups. Les violences ont cessé uniquement après qu’il a été contraint de signer un procès-verbal l’accusant de “trouble à l’ordre public” et de collusion avec des activistes en exil. Contacté par RSF, le directeur de Bonesha FM, Raymond Nzimana, s’est dit très inquiet pour la sécurité du journaliste, aujourd’hui menacé.
Les autorités sont restées silencieuses face à ces agressions et n’ont pas donné suite aux sollicitations de RSF. Le directeur de Bonesha FM affirme pour sa part, avoir déjà saisi le Conseil national de la communication (CNC), qui dément avoir été contacté. De son côté, le rectorat de l’Université du Burundi a publié un communiqué le 29 avril, niant la survenue de l’incident. Le 3 mai dernier, huit responsables des plus grands médias du pays ont dénoncé, dans un communiqué, les violences contre les journalistes dont celles à l’encontre de Willy Kwizera.
“La multiplication des attaques contre les journalistes burundais à l’approche des élections législatives et locales est extrêmement préoccupante. Le climat de peur instauré par les forces de sécurité et les ‘Imbonerakure’ vise à museler la presse indépendante et à entraver son travail, pourtant essentiel en cette période pré-électorale. RSF exhorte les autorités burundaises à garantir sans délai la sécurité des professionnels des médias sur l’ensemble du territoire, avant, pendant et après le scrutin. Il est aussi impératif que les responsables de ces violences soient identifiés et traduits en justice.”
Sadibou Marong, Directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF
Des violences démultipliées
Le 6 avril, un journaliste d’une radio communautaire, qui requiert l’anonymat craignant toujours pour sa sécurité, a été retenu plus de deux heures à un barrage à Bujumbura, alors qu’il rentrait du travail. Après la présentation de sa carte de presse, les policiers l’ont longuement contrôlé, lui reprochant son statut de journaliste. Trois jours plus tôt, un journaliste d’un média indépendant en ligne, qui lui aussi préfère garder l’anonymat, a été violemment interpellé par quatre policiers alors qu’il réalisait un reportage sur la pollution du lac Tanganyika. Bien qu’il ait indiqué sa profession, il a été publiquement humilié et dépouillé de son matériel. Des passants l’ayant reconnu ont exigé sa libération. Depuis, il craint pour sa sécurité, des membres présumés des“Imbonerakure” ayant menacé de le “corriger”.
Depuis la fermeture de plusieurs médias indépendants et la répression qui a suivi la crise politique de 2015, les journalistes burundais travaillent dans un climat de surveillance, de censure et de peur permanentes. La journaliste Sandra Muhoza fait par ailleurs l’objet d’une détention arbitraire depuis avril 2024 pour avoir relayé une information relative à une distribution présumée d’armes par le gouvernement en place, dans un groupe privé WhatsApp.
Le Burundi a chuté de 17 places par rapport à l’année dernière dans le Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2025 et occupe désormais la 125e place sur 180 pays et territoires.