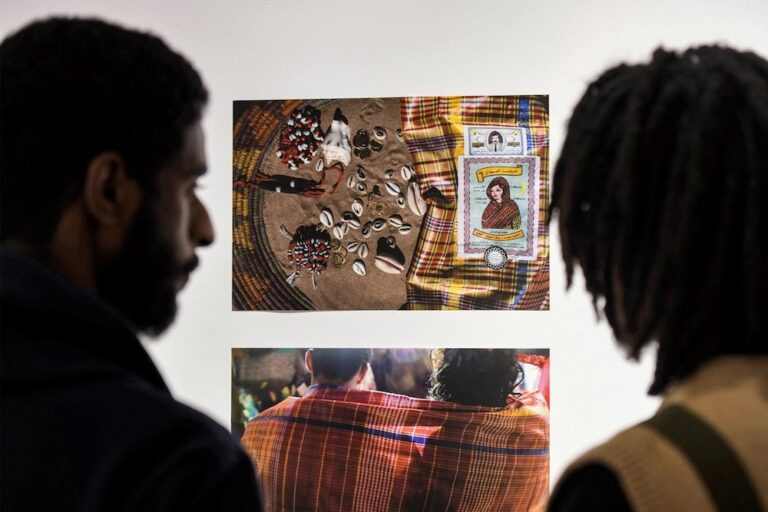(RSF/IFEX) – Ci-dessous, un communiqué de RSF: Lundi 9 août 1999 : diffusion immédiate Communiqué de presse Les vingt ennemis d’Internet Quarante-cinq pays contrôlent l’accès à Internet – la plupart du temps à travers un fournisseur d’accès unique – dont vingt peuvent être qualifiés de véritables ennemis de ce nouveau média. Sous couvert de protéger […]
(RSF/IFEX) – Ci-dessous, un communiqué de RSF:
Lundi 9 août 1999 : diffusion immédiate
Communiqué de presse
Les vingt ennemis d’Internet
Quarante-cinq pays contrôlent l’accès à Internet – la plupart du temps à
travers un fournisseur d’accès unique – dont vingt peuvent être qualifiés de
véritables ennemis de ce nouveau média. Sous couvert de protéger le public
« d’idées subversives » ou « de garantir la sécurité ou l’unité du pays »,
certains de ces régimes interdisent totalement à leurs citoyens l’accès à
Internet. D’autres gouvernements contrôlent le ou les fournisseurs d’accès,
ont mis en place des filtres qui bloquent les sites jugés indésirables ou
obligent tout utilisateur à s’enregistrer auprès de l’administration.
Pour les régimes autoritaires, Internet pose un double problème : d’une
part, il permet à tout citoyen de profiter d’une liberté de parole jamais
atteinte dans ces pays et constitue donc une menace. D’autre part, Internet
est un facteur de croissance économique grâce notamment au commerce
électronique et aux échanges d’informations techniques et scientifiques, ce
qui conduit certains de ces régimes à soutenir son développement. C’est
apparemment cette dernière option qui semble l’emporter, en Malaisie et à
Singapour par exemple, où le contrôle des sites jugés « dangereux » s’avère
difficile pour les autorités. De plus, les internautes trouvent des parades
à la censure: cryptologie, « serveur d’anonymat » (qui sert de relais pour
consulter des sites interdits ou échanger des e-mails), connexion par des
lignes internationales, cellulaires ou satellitaires, etc.
Reporters sans frontières a sélectionné vingt pays ennemis d’Internet, parce
qu’ils en contrôlent totalement ou partiellement l’accès, ont censuré des
sites ou se sont attaqués à des internautes. Ces pays sont : l’Arabie
saoudite, des pays d’Asie centrale et du Caucase (Azerbaïdjan, Kazakhstan,
Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan), la Biélorussie, la
Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, Cuba, l’Irak, l’Iran, la Libye, la
Sierra Leone, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Viêt-nam.
Arabie saoudite
Bien que trente-sept sociétés privées aient été autorisées à proposer au
public des connexions à Internet, tout le trafic transite par les serveurs
de la Cité des sciences et de la technologie (organisme public), équipés
d’un système de filtres, les fameux « firewalls », qui interdisent l’accès aux
sites proposant « des informations contraires aux valeurs islamiques ».
Internet est considéré comme un « vecteur nocif de l’occidentalisation des
esprits ».
Asie centrale et Caucase
Dans la plupart de ces pays, les autorités contrôlent ou limitent l’accès à
Internet. Au Tadjikistan, un seul opérateur, Telecom Technologies, détenu
par le gouvernement, fournit un accès à la Toile dans la seule ville de
Douchanbé. Le Turkménistan, véritable « trou noir » de l’information, offre un
accès encore plus restreint aux utilisateurs d’Internet. Malgré l’existence
d’opérateurs privés en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan, leur activité est
régulée par le ministère des Télécommunications, chargé de sanctionner les
voix critiques dans le pays. Au Kazakhstan, et dans une moindre mesure au
Kirghizistan, les autorités imposent aux opérateurs privés des frais
d’utilisation et de connexion prohibitifs.
Biélorussie
A l’instar de son attitude répressive à l’égard des autres médias, le régime
d’Alexandre Loukachenko ne laisse aucun espace de liberté sur le réseau
Internet dont l’accès est fourni par un seul opérateur, Belpak, qui
appartient à l’Etat.
Birmanie
La censure, grâce au monopole de l’Etat sur la fourniture d’accès, est
totale. De plus, la loi sur l’informatique de septembre 1996 oblige tout
possesseur d’un ordinateur à le déclarer à l’administration. Dans le cas
contraire, l’utilisateur risque jusqu’à quinze ans de prison.
Chine
Malgré un développement important d’Internet, les autorités tentent de
maintenir la pression sur les internautes, objets d’une surveillance
étroite: les utilisateurs du réseau doivent se faire obligatoirement
enregistrer. En janvier 1999, à Shanghaï, l’informaticien Lin Hai a été
condamné à deux ans de prison pour avoir fourni les adresses e-mail de 30
000 internautes chinois à un site dissident qui publie un magazine en ligne
à partir des Etats-Unis. Par ailleurs, alors que les autorités craignaient
des troubles à l’approche du dixième anniversaire du massacre de Tiananmen,
le 4 mai 1999, celles-ci ont ordonné la fermeture de trois cents cyber-cafés
à Shanghaï, sous prétexte qu’ils ne détenaient pas les autorisations
requises.
Afin de verrouiller l’accès des Chinois aux informations qui circulent sur
la Toile, les autorités bloquent certains sites, comme ce fut le cas pour
celui de la BBC en octobre 1998. Zhang Weiguo, rédacteur en chef du site en
chinois New Century Net (www.ncn.org), fondé aux Etats-Unis en 1996, estime
qu’il faut en moyenne deux mois pour que les autorités chinoises repèrent le
serveur-relais et le bloquent. Ces sites changent alors d’adresse. Certaines
pages censurées circulent par courrier électronique, à l’instar des journaux
clandestins photocopiés ou ronéotypés qui sont distribués « sous le manteau ».
Corée du Nord
Pyongyang ne dispose d’aucun accès à Internet. Le régime exclut délibérément
sa population de l’information autre que sa propre propagande. Les quelques
sites officiels à destination de l’étranger (agence de presse, journaux et
ministères) sont hébergés par des serveurs situés au Japon.
Cuba
Le pouvoir contrôle Internet comme les autres médias. Aucune expression
libre ne circule à partir du réseau national. Une dizaine d’agences de
presse indépendantes et illégales (Cubanet ou Cuba Free Press par exemple)
diffusent leurs informations par téléphone à des organisations installées à
Miami, qui les publient ensuite sur leurs pages web. Mais ces articles ainsi
diffusés n’échappent pas à la répression : en octobre 1998, un fonctionnaire
du ministère des Affaires étrangères a porté plainte pour « injures » contre
Mario Viera, de l’agence indépendante Cuba Verdad, suite à la publication
sur le site de Cubanet, basé aux Etats-Unis, d’un article le critiquant. Le
journaliste est toujours en attente de jugement; il risque dix-huit mois de
prison.
Irak
Bagdad ne dispose d’aucun accès direct à Internet. Les sites des journaux
officiels et de certains ministères sont hébergés par des serveurs basés en
Jordanie. En raison de l’embargo, le taux d’équipement en matériel
informatique est quasiment nul.
Iran
La censure d’Internet est identique à celle qui frappe les autres médias et
concerne les mêmes sujets: sexualité, religion, critique de la République
islamique, Israël, Etats-Unis, etc. En raison de filtres posés par les
autorités, l’accès à certains sites est interdit: des étudiants en médecine
n’ont pu avoir accès à des pages Web traitant d’anatomie…
Libye
Le pays n’est pas connecté au réseau mondial. Le régime maintient sciemment
la population hors des circuits internationaux de l’information, dans le but
de conserver son emprise sur les esprits.
Sierra Leone
Dans le contexte d’une répression visant la presse critique, les autorités
se sont également attaquées à un journal en ligne: en juin 1999, deux
journalistes du quotidien The Independent Observer, Abdul Rhaman Swaray et
Jonathan Leigh, ont été arrêtés. Il leur était notamment reproché de
collaborer avec le cyber-journal des « Ninjas », publié à partir d’un site
basé à l’étranger (www.sierra-leone.cc) par des journalistes entrés en
clandestinité.
Soudan
A travers Sudanet, l’unique fournisseur d’accès public, l’Etat contrôle les
connexions au réseau qui reste sous-développé dans un pays où la liberté
d’expression est régulièrement réprimée.
Syrie
L’accès au réseau est officiellement interdit aux particuliers. Toute
infraction est passible de peines de prison, comme tout contact « non
autorisé » avec l’étranger. Seules les institutions officielles peuvent
accéder à Internet via l’Etablissement public des télécommunications. Cet
unique fournisseur d’accès héberge les sites de journaux officiels, de
l’agence de presse et de quelques ministères.
Tunisie
L’Agence tunisienne Internet (ATI) exerce une tutelle sur les deux
fournisseurs d’accès privés, qui sont en réalité liés au pouvoir, l’un étant
dirigé par la fille du président Ben Ali et le second par un autre proche du
pouvoir. Leurs serveurs centraux contrôlent les connexions de certains
internautes. En novembre 1998, après la publication par Amnesty
International d’un rapport sur les atteintes aux droits de l’homme, un site
Internet, dont l’adresse (www.amnesty-tunisia.org) joue de la confusion avec
le nom de l’organisation non gouvernementale, vante l’action du président
Ben Ali en faveur des droits de l’homme. L’auteur de ce site, directeur d’un
cabinet de relations publiques, dont le pouvoir tunisien est l’un des
principaux clients, se défend d’avoir pris la défense de Tunis. L’accès au
site d’Amnesty International est bloqué sur le territoire tunisien.
Viêt-nam
Tout internaute est obligé de demander une autorisation au ministère de
l’Intérieur et de s’abonner auprès d’un des deux fournisseurs d’accès
publics. Les sites des associations vietnamiennes basées à l’étranger ou des
organisations internationales de défense des droits de l’homme sont bloqués.
Le 9 juin 1999, le ministère de l’Intérieur a ordonné la suspension de la
connexion du journaliste Nguyen Dan Que, un ancien prisonnier d’opinion,
après qu’il eut diffusé un communiqué par Internet un mois plus tôt.
Recommandations
Reporters sans frontières demande instamment aux autorités de ces vingt pays :
– d’abolir le monopole de l’Etat sur la fourniture d’accès au réseau ou, le
cas échéant, de ne plus contrôler les prestataires privés,
– d’annuler toute obligation d’enregistrement préalable des internautes
auprès de l’administration,
– de supprimer toute censure par le moyen de filtres, ainsi que le blocage
de certains sites hébergés par des serveurs étrangers,
– de protéger la confidentialité des échanges privés sur Internet, notamment
en cessant de contrôler le courrier électronique,
– d’interrompre toute poursuite pénale engagée à l’encontre d’utilisateurs
du réseau qui n’ont fait qu’exercer leur droit à une expression libre.
Reporters sans frontières demande à l’Arabie saoudite, la Birmanie, la
Chine, Cuba, le Kazakhstan et le Tadjikistan de ratifier et d’appliquer le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDC), dont
l’Article 19 stipule que « toute personne a droit (…) de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières (…) ».
L’organisation demande également aux Etats qui sont partie au PIDC
(Azerbaïdjan, Biélorussie, Corée du Nord, Irak, Iran, Kazakhstan,
Kirghizistan, Libye, Ouzbékistan, Sierra Leone, Soudan, Syrie, Tunisie et
Viêt-nam) de respecter leurs engagements.